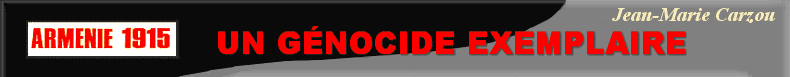L'Empire ottoman et la coexistence
Pendant plus de trois siècles, l'Histoire s'arrête donc pour ces populations chrétiennes que la puissance ottomane s'est soumises définitivement par la prise de Constantinople. A l'Est de l'Europe, largement étalé des deux côtés du Bosphore, l'Empire ottoman constitue un univers cohérent et solide, animé d'une vie propre, Orient lointain et stable que de rares visiteurs découvrent comme un autre monde. Certes, les relations existent entre cet Empire et les autres puissances, et les influences et les mélanges de civilisations sont constants ; du côté de l'Asie, les échanges commerciaux traditionnels se perpétuent avec l'Inde, la Chine, la Russie ; et puis, cet Empire qui recouvre la quasi totalité du monde arabe jusqu'aux frontières du Maroc est en contact constant avec l'Occident le long du grand lac méditerranéen. Mais son histoire est essentiellement faite de batailles, de conquêtes, de reculs, dans un incessant conflit pour la domination.
Au-delà des curiosités intermittentes pour ce monde exotique, l'Europe, de son côté, se soucie des Lieux Saints de Palestine et de Constantinople où elle voit, sous de nouveaux noms, les restes d'une présence et d'une origine dont elle ne veut pas se séparer. En France même, des liens se créent : Louis XIV reçoit en grande pompe les ambassadeurs du Sultan, mais déjà, en 1537, François Ier a signé avec Soliman un traité d'alliance ; venant peu après les Capitulations de 1535, ce traité constitue la première pénétration européenne dans l'Empire ottoman, accompagnée de franchises et d'un souci des populations chrétiennes minoritaires que l'on retrouvera désormais dans toutes les occasions de contact entre ces deux univers, en particulier à partir du traité de Kutchuk-Kaïnardgi, qui marque en 1774 le début de l'ingérence russe dans les affaires intérieures turques. Mais, plus directement, le contact est fait ici aussi de luttes, luttes d'abord défensives, puisque la progression ottomane vers l'Ouest n'est arrêtée que deux siècles après la chute de Constantinople, aux portes de Vienne, en 1683. Et c'est alors, très exactement, que commence de ce côté le déclin de l'Empire ottoman ; certes, ce n'est pas encore « l'homme malade » qui sera au centre des préoccupations européennes du XIXe siècle, mais l'élan est stoppé et c'est d'Europe que viendront désormais, bientôt, les ambitions, les initiatives, les menaces de plus en plus précises.
A l'intérieur de l'Empire, ces événements restent cependant sans conséquence et, durant ces trois siècles, la situation des populations chrétiennes est stable. Jusqu'au début du XIXe siècle, en effet, c'est un même système de gouvernement qui fonctionne, système établi dans le cours du XVe siècle, mais fondé sur un ensemble de schémas religieux et politiques bien antérieur dont la force d'influence est impressionnante dans sa durée et dans ses effets. Et si les événements de politique étrangère ou les péripéties du Palais ne provoquent encore aucune modification dans le statut des populations chrétiennes, c'est bien sûr parce que l'Empire est assez puissant pour tout maintenir en état. Mais c'est aussi que l'organisation de l'Etat est fondée sur une distinction fondamentale entre croyants et non-croyants : avec l'adoption de l'Islam, les Touraniens ont mis sur pied un Empire théocratique où le chef de l'Etat, le Sultan, est en même temps le commandeur des croyants, le chef spirituel. Tout repose sur ce fondement religieux : auprès du Sultan, une seule autorité de recours, le Cheikh-ul-Islam, qui est le gardien de la foi — et c'est à lui que l'on demande d'avaliser toutes les décisions importantes (élévations au trône, destitutions, déclarations de guerre, etc.) : sans un fetva, rien n'est possible. De même, c'est sur l'Islam et le Livre, le Coran, que repose tout l'édifice politique, juridique, social : tout découle du Chéri, loi fondamentale de l'Islam, émanée du Prophète avec le Coran ; et si le Sultan peut, par recours à l'Eurf, expression temporelle de sa propre volonté, modifier toutes les structures de son pouvoir, il faut toujours que ce soit en conformité avec le Chéri. C'est là qu'interviennent les fetvas, décisions arbitrales du Cheikh-ul-Islam, en tant justement qu'il représente le respect et la garantie de la tradition religieuse où tout acte du croyant trouve sa source.
De ce fait, c'est en toute logique que l'organisation sociale repose sur une différenciation religieuse ; puisque tout remonte à l'Islam, c'est de l'Islam que vient la caractérisation des populations, et ce d'autant plus aisément que ce n'est pas là une figure théorique résiduelle, encore qu'elle puisse évidemment être utilisée aussi comme telle, mais bien quelque chose de vivant qui est ressenti ainsi par tous les musulmans. Dans une confusion naturelle entre le pouvoir et la foi, ils sont en même temps les maîtres et les croyants : aux autres ne reste que le rôle de sujets, puisqu'ils sont les Infidèles. La certitude religieuse a d'ailleurs toujours accompagné dans son élan l'action de l'Empire et toutes les guerres sont des Djihad, guerres saintes que le peuple qui a la vraie foi mène contre les Infidèles à l'appel mêlé du Sultan et du Cheikh, relayé de toutes les mosquées par la voix des muezzins.
Les peuples chrétiens sont donc les rayas, ce bétail servile auquel on laisse toutes les tâches économiques ; car, même si le gouvernement arrache aux chrétiens bon nombre de leurs fils pour en faire ces troupes d'élite que seront les janissaires, la responsabilité militaire est en ces temps guerriers tout entière entre les mains des Ottomans : comment imaginer d'ailleurs de la laisser à des Infidèles ? Mais le signe essentiel de la soumission des chrétiens au pouvoir musulman, c'est l'impôt : d'abord tribut de capitation auquel sont assujettis tous ceux que les détenteurs de la vraie foi ont rangés sous leur autorité et qui a nom djizié, puis taxe d'exemption du service militaire ou bédéli-askérié, il est source dans les deux cas d'abus permanents. Car le raya est taillable et corvéable à merci : non contents d'obtenir de lui tous les moyens de la subsistance quotidienne, et imbus de leur supériorité, les conquérants, quelle que soit leur place dans la société ottomane, tirent de lui par la force toutes sortes de redevances supplémentaires et arbitraires, en espèces et en nature. Voyageant en Turquie d'Europe, Blanqui dira ainsi d'eux un peu plus tard : « Ils ont des rayas à piller comme nos paysans ont des terres à mettre en culture4. »
Aussi une partie de l'élite chrétienne, sachant le précieux concours qu'elle apporte à l'Etat de par ses capacités commerciales et intellectuelles, n'hésite-t-elle pas à se convertir à la religion dominante et s'intègre-t-elle à la caste dirigeante, fournissant ainsi au fil des siècles au Sultan nombre de pachas ou de vizirs d'origine le plus souvent grecque ou albanaise. Simultanément d'ailleurs, la communauté grecque installée à Constantinople dans le quartier du Phanar met au service du divan, qui constitue à cette époque le conseil de gouvernement du Sultan, des interprètes, des conseillers, des secrétaires par lesquels elle se ménagera jusqu'en 1821 une grande influence sur l'action diplomatique de l'Empire.
Durant ces longues centaines d'années, le système adopté fait donc des populations chrétiennes un monde d'esclaves au service des croyants. Mais aussi il les tolère et, par un renversement étonnant pour qui a vu de la conquête touranienne naître tant de destructions et de ruines, accepte et organise leur survie, une survie que, de surcroît, il laisse s'organiser de façon spécifique, et dans tous les cas sans toucher à ce qui, alors, est le plus précieux pour elles et sans quoi elles ne seraient plus rien, leur identité religieuse. Bien sûr, on s'efforce par tous les moyens de multiplier les conversions à l'islamisme et les vexations, les brimades, même graves, sont fréquentes ; mais le fait est là : au début du XIXe siècle, trois cent cinquante ans après la conquête de ces régions par des Touraniens musulmans, non seulement les populations qui les habitent n'ont pas fait l'objet d'un massacre systématique, mais elles ont tout conservé : leurs coutumes, leur langue, leur religion, avec tout ce que cela implique quant à l'exercice des rites, au maintien d'une hiérarchie propre, à laquelle le Sultan délègue même certains pouvoirs d'organisation locale.
C'est ainsi que le patriarche arménien de Constantinople se voit attribuer des pouvoirs religieux et civils sur la communauté arménienne, et même à une certaine époque la tutelle sur d'autres populations chrétiennes aux théologies proches. Et ces pouvoirs ne sont pas négligeables : gestion du patrimoine (églises, couvents, écoles, hôpitaux, biens immobiliers), exercice du culte et entretien du clergé, assistance et éducation des membres de la communauté, tenue de l'état civil, règlement des conflits internes ; face aux autorités turques, le patriarche est également responsable de la perception des impôts.
On trouvera souvent d'ailleurs des témoins ou des voyageurs pour reconnaître et admirer, en un temps où pareille tolérance est si rare, une pratique politique qui assure l'unité et la force de l'Etat tout en préservant certains droits propres des minorités. Et les Turcs seront en droit, plus tard, d'opposer cette attitude aux excès d'une Inquisition qui n'est pas si loin, ou aux persécutions subies par les protestants en France.
Il entre certainement dans cette tolérance une part de calcul et de réflexion politique. Le maintien d'une telle attitude eût été sans cela impossible durant tant de temps. A peine Mahomet II est-il vainqueur qu'il reconnaît « l'Eglise grecque avec toutes ses prérogatives du passé », dit un historien turc du début de ce siècle qui déplore en même temps cet acte comme « premier jalon de la discorde10 » entre musulmans et non-musulmans. Toujours est-il qu'en 1453, Mahomet II conclut le pacte de l'aman (qui implique l'octroi de la protection en échange de la soumission et du paiement de l'impôt) avec la communauté grecque, et en 1461 avec la communauté arménienne ; à cet effet, il fait venir à Constantinople l'archevêque de Brousse, Ovakim, qui devient ainsi l'intermédiaire officiel du gouvernement.
Peut-être aussi la certitude acquise dans tant de succès alors manifestement définitifs a-t-elle calmé la soif des envahisseurs et sont-ils satisfaits pour leur gloire de régner sur tant de populations et sur tant de chrétiens. Il semble bien, en effet, que la prise de Constantinople, témoin fulgurant du succès touranien, marque la fin de ces atrocités qui ont accompagné la marche des « hordes » à partir de leurs terres originelles d'Asie centrale ; et on ne les verra pas réapparaître avant 1822, au détriment d'abord, cette fois, des populations grecques. Assurément enfin, comme dans les grands Empires des anciens temps, la faculté de disposer d'une telle masse de travailleurs, de femmes, d'enfants, n'est pas négligeable et garantit, à côté de la sécurité militaire qui n'est confiée qu'aux musulmans, une sécurité économique à bon compte. On ne tue pas le bétail qui vous fait vivre... Mais il faut voir aussi dans cette attitude l'application pure et simple des préceptes du Coran, de cette loi fondamentale de l'Islam qui régit longtemps tous les actes des musulmans ; et s'il arrive, comme dans toute religion, que la Loi serve les intérêts momentanés de tel ou tel clan, elle reste avant tout l'expression profonde d'une foi à laquelle on est tenu vraiment et qui s'impose longtemps. On le voit bien au début du XVIe siècle, quand, après avoir fait recenser et tuer les 40 000 Persans établis dans son Empire, Sélim Ier surnommé Yavouz (le bon)10 envisage de massacrer tous les chrétiens qui refuseraient de se convertir à l'islamisme : le Cheikh-ul-Islam, Djemali, lui en refuse l'autorisation en s'appuyant sur le verset du Coran où il est dit : « Personne ne sera forcé de suivre la religion du Prophète10. » C'est donc le respect de la tradition islamique qui a empêché le massacre ; le cas est intéressant parce qu'il est unique et nous montre ainsi, par contrecoup, quelle a été durant ces trois siècles la réalité de l'Empire ottoman.
Que devient alors l'Arménie ? Il en va pour elle comme de toutes les nations chrétiennes que la fin de l'Empire d'Orient a précipitées définitivement sous le joug ottoman, disparues et asservies au sein d'un Etat dominateur. Elle conserve néanmoins son identité, au travers de son organisation religieuse, organisation d'autant plus privilégiée et bénéfique qu'elle est spécifique — il n'y a alors en Arménie qu'une Eglise dite souvent grégorienne, définitivement indépendante de Rome à la suite du synode national arménien de Vagharchapat en 491 — et qu'elle implique simultanément le maintien et la pratique d'une langue et d'un alphabet propres. Par ailleurs, une partie de la communauté arménienne, celle qui réside dans la capitale, s'est parfaitement adaptée au système social, politique et économique des vainqueurs ; comme le dit lui-même un historien arménien récent, « les Arméniens voyaient dans les Turcs ottomans un peuple touranien qu'ils estimaient supérieur aux autres par leur énergie, leur discipline, leur esprit d'organisation. Les Turcs ottomans de leur côté appelleront longtemps les Arméniens « la nation fidèle » (milleti sadykà)26 ». A Constantinople, comme les Grecs, les Arméniens deviennent donc rapidement les interprètes, les juristes, les banquiers, formant cette bourgeoisie cultivée en partie assimilée qui manquait au conquérant et qui l'aide à asseoir son autorité et à gérer ses affaires face au monde extérieur.
Au XVIIIe siècle, et souvent sous l'impulsion du Catholicos, chef religieux et temporel de la communauté dont le siège spirituel, Etchmiadzine, est alors sous domination persane, des tentatives ont néanmoins lieu pour susciter un mouvement vers la reconquête de l'indépendance, tantôt insurrectionnelles, tantôt diplomatiques (Israël Ori et Joseph Emin feront ainsi de longs périples dans les cours d'Europe, promettant la couronne de l'Arménie à qui la délivrera). C'est que la renaissance intellectuelle est déjà effective : depuis 1512, date du premier livre en arménien, les imprimeries se sont partout multipliées et contribuent à maintenir vivante la langue, cette langue qui est le premier signe de l'existence d'une nation — et c'est entre 1712 et 1795 que vit Sayat Nova, le plus grand des trouvères arméniens. De plus, à l'instigation d'un moine nommé Mekhitar Sebastatsi, une congrégation s'est installée à Venise (1717) et à Vienne (1807), deux centres qui seront désormais essentiels pour le rayonnement de la culture arménienne. Simultanément, enfin, l'émigration s'est développée, jusqu'en Pologne d'un côté, vers les Indes de l'autre, où la colonie, importante, fonde en 1792 le premier journal arménien. C'est le temps où l'Europe redécouvre les Arméniens, ne serait-ce qu'à travers le folklore que symbolise le bonnet dont Jean-Jacques Rousseau aimait à se coiffer.
Au début du XIXe siècle, l'Empire ottoman se présente donc comme un très vaste Etat musulman, dans lequel de fortes minorités chrétiennes conservent par-delà leur statut inférieur une part notable de leurs caractères propres ; et c'est ce qui fait son originalité par rapport à d'autres formes d'organisation sociale. Mais nous nous trouvons, en fait, devant une situation bloquée dans laquelle les communautés restent distinctes : il y a eu certes des mélanges raciaux, des influences culturelles réciproques, il y a des liens permanents, mais pas de melting pot, et c'est encore là l'un des effets d'une tolérance qui n'est pas niable. Les populations chrétiennes supportent le sort qui leur est fait, mais elles ne se fondent pas dans la race victorieuse : il n'y a pas d'assimilation et l'on pourrait qualifier cette présence les unes à côté de l'autre de coexistence à peu près pacifique. Cet état de choses dure longtemps, aussi longtemps que rien ne menace sérieusement la prospérité de l'Empire, mais il est évident qu'il ne peut régler le problème latent posé par la distinction fondamentale entre maîtres et sujets, distinction que renforcent aussi bien le statut différent donné aux uns et aux autres dans la vie de l'Etat que les divergences profondes de civilisation qui les séparent ; bien plus, quand le temps des malheurs sera arrivé, rien de plus inévitable que de voir dans ces populations que tout rattache aux Etats voisins devenus de puissants adversaires d'un Empire déclinant ces fameux « ennemis de l'intérieur » dont tout pouvoir a aujourd'hui l'obsession...
Arménie 1915, un génocide exemplaire, Flammarion, Paris 1975
édition de poche, Marabout, 1978